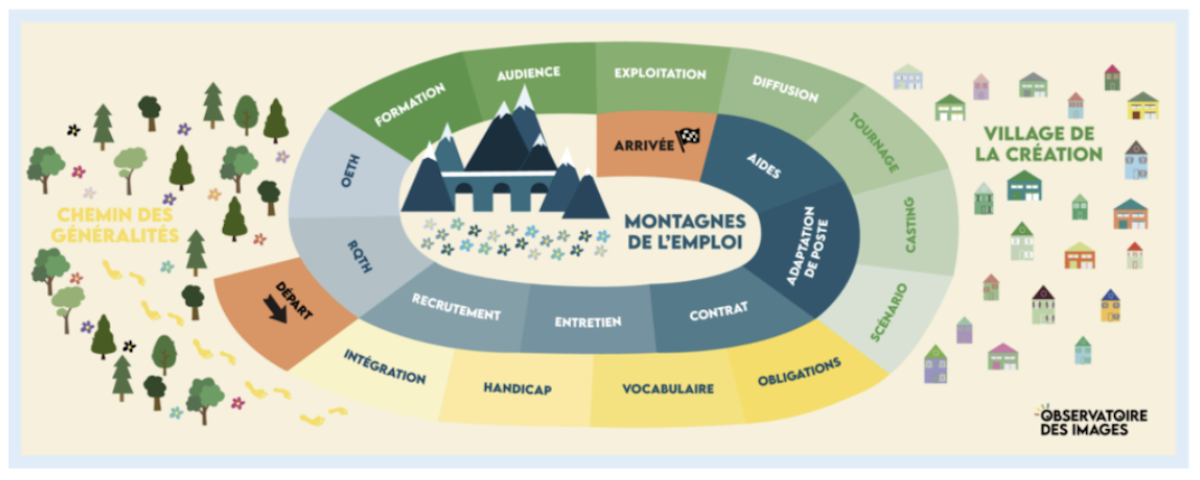Représentation des handicaps visibles et invisibles
La question de la représentation des handicaps ne se limite pas à leur faible fréquence, mais concerne également la façon dont ces représentations sont construites. Comme le souligne l’Observatoire des images dans son Focus #12, “c’est la nature même de la représentation du handicap qui est problématique”. Dans les fictions audiovisuelles, les personnages en situation de handicap sont souvent réduits à leur condition, présentée comme leur seule caractéristique narrative. Ils sont fréquemment dépeints sous des angles simplistes, soit suscitant la pitié, soit incarnant un héroïsme exagéré pour avoir surmonté leur handicap. Ces clichés, largement répandus, demeurent le schéma dominant dans les récits.
Cette tendance est corroborée par une étude américaine du National Research Group sur la représentation des personnes sourdes. Elle révèle qu’en 2022, 63% des spectateur·rices sourd·es estimaient que Hollywood représentait leur communauté à travers des stéréotypes négatifs. Cela met en lumière la persistance de récits qui peinent à refléter la diversité des expériences réelles.
Toutefois, certaines initiatives tentent de faire évoluer ces représentations, y compris dans des domaines inattendus comme les jeux vidéo. Par exemple, Joy, une tenue personnifiée dans le célèbre jeu vidéo Fortnite marque une avancée notable : elle vit avec le vitiligo, une dépigmentation de la peau particulièrement visible sur les personnes de couleur. En plus d’accroître la visibilité de cette dermatose, le jeu vidéo l’accompagne d’un texte descriptif, sensibilisant ainsi les joueur·euses à cette condition. En revanche, comme le souligne The Gamer, cette représentation reste limitée puisque Joy se réduit à un choix vestimentaire dans le jeu vidéo.